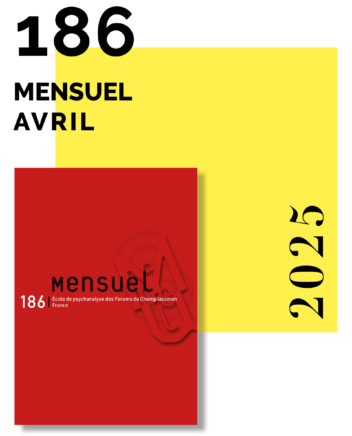Édito
Chers lecteurs,
Dans ce Mensuel du mois d’avril, il sera question, entre autres, de la nécessité pour l’être humain d’adresser sa parole, de constituer un lieu d’adresse pour que quelque chose d’inouï puisse se faire entendre, résonner peut-être. C’est aussi la fonction de ce petit journal, de susciter un désir de dire, d’écrire, de transmettre ce qui pour chacun fait le sel d’un rapport toujours singulier à la psychanalyse lacanienne.
Dans « L’adresse du parlêtre », Natacha Vellut nous fait part de la rencontre avec Philippe Descola, anthropologue français, lors du séminaire Champ lacanien en janvier dernier. Il évoque son travail et les années passées auprès de certains peuples d’Amazonie, notamment les Indiens jivajos achua. Ils sont dits animistes, c’est-à-dire qu’ils confèrent au non-humain, plantes, animaux, esprits, des propriétés humaines. Il est donc possible de s’entretenir avec eux, de leur adresser une parole, un chant, une prière. Descola témoigne de cette conversation infinie entre humains et nonhumains notamment grâce à la place faite aux rêves.
L’anthropologue Nastassja Martin, élève de Descola, dans son livre Croire aux fauves, témoigne elle aussi de ce que fut sa rencontre avec le non-humain et de l’empreinte qu’il laissa. Elle y relate comment sa route croisa celle d’un ours dans les montagnes du Kamtchatka. Elle faillit perdre la vie. Elle en réchappa mais ne fut plus la même : il s’agit alors « d’arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l’autre ; arriver à vivre avec ce qui y a été déposé [1] ». La perte d’abord, l’effraction du corps par la douleur, les premiers soins prodigués dans un milieu hostile. Un premier nouage avec la langue entendue alors. Des mots de différentes langues émaillent le récit de sa survie et témoignent de la frappe du langage sur le corps : molodiets, kormit, potierpi sont associés pour elle aux moments les plus vifs de douleur éprouvée. Une langue qu’elle comprend, mais qui n’est pas sans comporter une part d’étrangeté chiffrant ainsi l’indicible de la souffrance. C’est aussi cela, « arriver à vivre avec ce qui a été déposé ». Elle interroge dans son récit les signifiants venus de l’Autre, notamment son nom de baptême évène, matukha, qui signifie « ourse ». L’ours vient peupler ses rêves. Elle en entreprend le déchiffrage via l’écriture dans un cahier « nocturne » dans lequel elle consigne ses pensées au contenu « partiel, fragmentaire, instable. […] ça parle à travers moi ».
Dans ce livre, Nastassja Martin ne recule pas face à ce qui lui revient de traiter via les mots d’une jouissance rétive au sens, sans Autre pour en être comptable. À la frontière de l’humanité. Elle s’en fait responsable en interrogeant la part d’elle, nocturne, qui s’en est allée dans la gueule de l’ours.
Ce non-humain dont nous sommes le siège en tant qu’« animaux parlants », n’est-ce pas ce qui nécessite une adresse, une destination pour que s’entendent « ce qui a été perdu et ce qui a été déposé » ?
[1] N. Martin, Croire aux fauves, Paris, Gallimard, 2019.
Karine Benaben
Édito
Séminaire École
J. Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant
Séance du 19 mai 1971
-
p. 6-15
Le sexe et l’existence
David Bernard

-
p. 16-23
L’homme et la femme et la logique
Patricia Zarowsky

Fragment
Qu’enseigne la psychanalyse ?
Séminaire École
Les Cercles cliniques
« Comment débute une psychanalyse ? »
-
p. 44-45
Présentation

-
p. 46-47
Ouverture
Nadine Cordova et Anastasia Tzavidopoulou

-
p. 48-53
De la parole à l’association libre
Patricia Gavilanes

-
p. 54-59
« De … à … », quels débuts ?
Kristèle Nonnet-Pavois

IVe Convention européenne de l’Internationale des Forums
Venise, 12-14 juillet 2025
Journée de l’École « La passe : expérience et témoignages »
2Réplique
L’enfant, le sexuel, toujours traumatique ?
Séminaire Champ lacanien
-
p. 74-77
L’adresse du parlêtre. Retour sur la séance du séminaire Champ lacanien avec Philippe Descola
Natacha Vellut